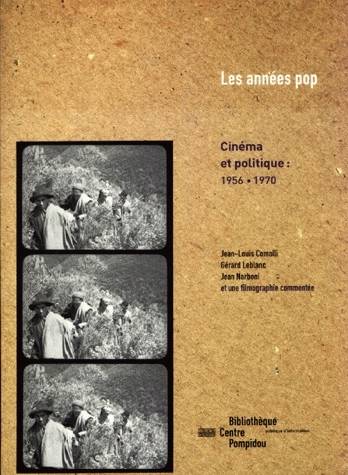Écrire pour voir
(trois interventions de Jean-Louis Comolli)
première partie
Les mises en garde de Jean-Louis Comolli se tiennent dans la garde des boucles récursives du regard. La place du spectateur est ainsi un objet de construction et de réflexion, de pratique et d'interrogation : un enjeu de lutte. Le cinéma a alors de l'avenir, comme un relevé des traces existantes qui est la relève de ses propres traces, depuis le regard du spectateur qui est celui de l’autre dont nous avons la garde.
« Dans l'inscription vraie, il n'y a que des traces de l'inscription dont on soit sûr. Le reste est métamorphose, avatar, double identité et double appartenance, erreur, trahison. » (Serge Daney, « Une morale de la perception (De la nuée à la résistance de Straub-Huillet) » in La Rampe. Cahier critique 1970-1982, éd. Cahiers du cinéma-coll. « Petit bibliothèque des Cahiers », 1996 [1983 pour la première édition], p. 149)
Ouverte au public en janvier 1977, la Bibliothèque Publique d'Information (BPI) est, à titre d'établissement public national sous tutelle du Ministère de la culture et associé organiquement au Centre Georges-Pompidou, une institution qui compte dans la valorisation de la part documentaire du cinéma. Elle est autrement astreinte à une position minoritaire, les effets symboliques de la relégation effectivement déterminés par une marginalisation triplement commerciale, industrielle et économique.
La BPI organise depuis le milieu des années 1970, d'abord sous l'impulsion du documentariste Jacques Willemont puis de Jean Rouch et Jean-Michel Arnold, le Cinéma du réel, l'un des festivals internationaux consacré au cinéma documentaire parmi les plus importants du pays, dont la quarantième édition est prévue pour le printemps 2018. Le catalogue national de films documentaires pour les bibliothèques qu'elle promeut propose également à destination des équipements culturels des collectivités territoriales, municipalités et départements principalement, entre 1200 et 1500 titres dont les droits acquis auprès des réalisateurs, des producteurs et des distributeurs permettent de garantir les moyens d'une représentation publique des films en assurant la gratuité d'accès aux usagers dans le respect du droit d'auteur. C'est, encore récemment, la mise en place décrétée en novembre 2017 d'une Cinémathèque du documentaire, proposée par la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM), instituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public coordonné par la BPI et auquel sont associés entre autres la BNF et le CNC afin de promouvoir le cinéma documentaire sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cette perspective longue de quatre décennies que s'organise un double travail de mise en place d'expositions, de rencontres et de manifestations, mais aussi d'inscription éditoriale de leurs archives visuelles et textuelles dans le cadre d'une édition appropriée (les Éditions du Centre Pompidou).
On retiendra entre autres les manifestations Réalités urbaines et Filmer l'histoire,. Coordonnées par Sylvie Astric, elles se sont respectivement tenues, pour l'une du 6 avril au 9 mai 1994, et l'autre du 15 au 27 janvier 1997, suivies de la publication d'ouvrages malheureusement épuisés depuis et destinés à une collection circonstanciée (« Supplémentaires »). Il faudra également mentionner l'édition d'un catalogue à l'occasion de la manifestation Cinéma et politique dans le cadre de l'exposition Les Années pop entre le 15 mars et le 18 juin 2001. Soit autant d'occasions pour Jean-Louis Comolli de multiplier avec quelques pairs les interventions toujours comprises comme des prises de position (pour l'écriture contre le spectacle), au carrefour de la théorie et de la pratique cinématographique, la pensée du cinéma en sa part documentaire se frottant successivement aux questions respectives de l'urbanisme, de l'histoire et de la politique.
Aux côtés de l'ethnologue Gérard Althabe et de l'anthropologue et réalisateur Jean-Paul Colleyn (pour Regards sur la ville), du philosophe Jacques Rancière (avec Arrêt sur histoire), de l'historien du cinéma Gérard Leblanc et du critique Jean Narboni (pour Cinéma et politique : 1956-1970), Jean-Louis Comolli mobilise l'exemple des films qui lui importent et dont certains relèvent d'un corpus qui lui est cher, en participant à soutenir une réflexion exceptionnellement menée sur le double front de la pratique, dans la conjugaison redoublée de l'écriture critique et de la réalisation cinématographique. Ce dont témoigneront entre autres les volumes Voir et pouvoir (2004) et Corps et cadre (2012), ainsi qu'un film aussi déterminant que Cinéma documentaire, fragments d'une histoire (2014).
Ces films qui comptent permettent en particulier à Jean-Louis Comolli de persévérer à problématiser la dimension documentaire d'un art qui soutient toujours l'apprentissage des regards, au prisme ontologique de l'enregistrement des traces du réel et de leur organisation signifiante via la composition des fragments retenus. Dans la ville, face à l'histoire comme dans les rapports de l'histoire et de la politique, le sujet comollien privilégié resterait, davantage même que l'auteur, le spectateur : le spectateur qui regarde les visions de la ville qu'il peut habiter ; le spectateur qui observe les représentations de l'histoire en ne cessant jamais d'être un sujet historique ; le spectateur invité à penser la question de la cause politique depuis la place que le film lui aménage et qui n'est rien moins que politique.
C'est d'ailleurs ainsi que Jean-Louis Comolli conclura son intervention pour Regards sur la ville, intitulée « La ville filmée » : « La question de la place du spectateur devient, par là, celle de la place politique du spectateur. » (p. 58).
La ville non-indifférente
(cf. « La ville filmée » in Regards sur la ville,
éd. Centre Georges Pompidou-coll. « Supplémentaires », 1994)
Le rappel, s'il est élémentairement matérialiste, ne l'est cependant que dans la prise en compte de la dimension proprement matérielle du médium. Preuve en est que Jean-Louis Comolli, avec une plus grande souplesse terminologique qu'à l'époque de « Technique et idéologie » (1971-1972), n'aura jamais cédé d'un iota dans la considération de la machine qu'il pense, ressaisie dans le tissu de rapports dont est redevable l'acte de création qui s'y accomplit. La machine, précisément la caméra, se présente en effet avec son « œil unique » comme une « machine cyclopéenne [qui s'oppose] au système binoculaire qui est le nôtre » (p. 13). Et celle-ci impose la construction d'un point de vue artificiel et partiel qui, réglé selon des distances focales, recoupe géométralement l'illusion optique de la profondeur. Dit autrement c'est la perspective dont André Bazin disait, dans une phrase fameuse reprise par Jean-Luc Godard, qu'elle était le péché originel de la peinture occidentale dont Niépce et Lumière furent les rédempteurs (Qu'est-ce que le cinéma ?, éd. Cerf, 2002, p. 12).
« L'œil est au bout de l'image » dans la construction des regards et la perception visuelle du spectateur et s'il ne se confond jamais avec l'objectif de la caméra, il en est cependant tout imprégné et traversé – appareillé (p. 14). En ajoutant le découpage du temps (privilégié par le montage) à celui de l'espace (priorisé par le cadrage) dans la structuration du film, Jean-Louis Comolli peut en conclure que la ville perçue et vécue par le passant, dans ses formes comme dans ses rythmes, ne peut équivaloir à la même ville représentée au cinéma, qui propose d'autres formes et d'autres rythmes indexés sur sa logique commandant à son appareillage. Cette distinction, partagée par l'architecte Marco Venturi invité par le réalisateur à intervenir aux États généraux du film documentaire de Lussas, fonde un écart au principe de l'ensemble de la réflexion comollienne : « Il se peut même que cet écart par rapport au visible soit la dimension juste du cinéma » (p. 17). Cet écart s'inscrit paradoxalement dans l'histoire d'une quasi-synchronisation, l'extension des villes modernes s'accentuant à l'époque industrielle qui aura vu également apparaître successivement les techniques d'enregistrement photographique et de projection cinématographique.
Depuis les vues Lumière, se manifeste en effet une « demande de cinéma » (p. 17) qui aura débouché au bout de quelques années sur plusieurs exercices virtuoses et différenciés, donnés par Manoel de Oliveira et Jean Vigo (Douro, faina fluvial et A propos de Nice en 1930), déjà avec Walter Ruttman et Dziga Vertov (Berlin, symphonie d'une grande ville en 1929 et L'Homme à la caméra en 1929), d'une « cinématique urbaine » (p. 19). Esthétisée graphiquement (Walter Ruttman et Manoel de Oliveira), sublimée idéologiquement (Dziga Vertov) ou bien hystérisée dans l'optique politique d'un forçage caricatural (Jean Vigo), la ville au cinéma s'expose à l'instar de la nature pour Sergueï Eisenstein : non-indifférente.
L'excitation urbaine, qui se manifeste encore dans les figures des documentaires des suisses Alain Tanner et Claude Goretta (Nice Time en 1957) ou des anglais Karel Reisz et Tony Richardson (Momma Don't Allow en 1955), laissera place à de nouvelles expressions attentives à la modernité urbaine comme site de l'insignifiance (L'Amour existe de Maurice Pialat en 1961) et, finalement aussi, d'une indifférence persistante (Six fois deux : sur et sous la communication de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville en 1976). Par exemple avec l'épuisement relatif des corps désirant la ville ou alors comme traces d'un passé à préserver afin qu'il ne disparaisse pas (L'Amour rue de Lappe de Denis Gheerbrant en 1984). Hors, si, dans des rapports cruellement inclusifs (Roberto Rossellini) ou souverainement exclusifs (Michelangelo Antonioni), le cinéma « filme l'indifférence, c'est encore pour la sauver de cette mortelle insignifiance qu'il ne supporte plus. » (p. 27).
La grande série documentaire ouverte avec Marseille de père en fils (1989) s'invite aussi comme objet d'examen où la réflexion avoue toujours se doubler d'une dimension d'auto-réflexion. Feuilleton à rebondissements en une quasi-dizaine d'épisodes tournés sur un quart de siècle (si l'on y inclut Marseille entre deux tours en 2015), essai sur la portée du « geste documentaire » (Patrick Leboutte) voisinant avec la comédie humaine balzacienne, enquête ethnographique au long cours consacrée à l'observation d'un champ politique où le local vaudrait aussi comme bocal du national (c'est la métaphore privilégiée du laboratoire pour le Front National) : la série des neuf films tournés par Jean-Louis Comolli avec Michel Samson déploie le vaste chantier d'une ville à filmer, désirée depuis l'aveuglante duplicité d'une générosité feinte (Marseille est riche en signaux) et d'une résistance à se livrer (il faut suivre quelques indices indiquant les endroits où Marseille ne se dit plus, se soustrait ou se retire). La cité phocéenne est ainsi envisagée comme site d'élection où, indépendamment de la question de la représentation politique dont la scansion rituelle est celle des élections, s'y éprouve la vérité d'un médium consistant à « bousculer les évidences du sensible » (p. 31). Jamais épuisée par les images dont elle aura innervées la fabrication, « plus et moins que la somme de ses images » (p. 32), Marseille se donne à voir dans un geste qui la symbolise, à la fois comme métaphore et comme métonymie. C'est, par exemple, celui de la main en visière de Voudia Slimani regardant au loin comme une vigie. C'est encore la montée des escaliers de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde par Zohra Maaskri qui incorpore autrement la ville.
Marseille se livre dans les corps et les gestes qui dénotent de son incorporation comme elle se retire dans « la conjonction-disjonction du champ et du hors-champ » où se tient « l'ambivalence de l'inscription du même et de l'autre au cinéma. » (p. 35). C'est encore l'une des valeurs associées à l'usage circonstancié du mouvement panoramique qui est au service de la continuité de l'ensemble filmé dans la perspective d'un tout cohérent, en dépit d'une hétérogénéité urbaine jamais déniée. Les corps sont aussi des vecteurs pour apprécier la « ville-palimpseste » et la réactivation des traces qui s'y sédimentent (p. 41). Jusque dans la disparition des traces physiques elles-mêmes, comme dans Chronique d'une banlieue ordinaire (1992) de Dominique Cabrera ou, différemment, En remontant la rue Vilin (1992) de Robert Bober. De son côté, Les Vivants et les morts de Sarajevo (1993) de Radovan Tadic fait du hors-champ un site jamais délié de la zone de mort où s'activent contre les civils les snipers. S'y vérifie alors, et dans tous les cas, la « résistance ontologique du cinéma » à ce qui, dans le réel est mort, décomposé en remords et ruines (p. 43).
Autre grand moment : celui où Marseille se diffracte lors de la séquence de la « confession de Milou », ce plan-séquence en travelling-arrière de cinq minutes tourné sur un quai de la Joliette promenade, « le long d'un car-ferry algérien » (p. 45) précise l'auteur dans une précision par où se glisse discrètement la touche proustienne de l'autobiographie. Ce qui s'enregistre sans s'énoncer est un malaise résultant de la divergence entre Charles-Émile Loo, une figure locale du Parti Socialiste qui se met en scène comme l'héritier d'une certaine fable marseillaise, et Michel Samson, le journaliste et co-auteur de la série documentaire, qui lui n'y croit guère. Un se divise en deux : cette dissociation passe dans le rapport des corps filmés ensemble et la discordance qui s'y infiltre. Pour reprendre le titre programmatique du premier film tourné en 1968 par Jean-Louis Comolli avec André S. Labarthe pour la série Cinéaste de notre temps et consacré à Pierre Perrault, « l'action parlée » est aussi au principe d'une « cinégénie » autorisant le regard impersonnel de la machine caméra, « ce regard de personne » appelé à « devenir regard et conscience du spectateur » (p. 47).
Cela, le sauvetage de ce qui est advenu (l'ontologie bazinienne persiste dans la réflexion comollienne, moins comme essence que comme fonction, comme retournement matérialiste par le disciple d'un maître supposé idéaliste), la substitution de la vidéo à la pellicule et du numérique à l'analogique travaille à la désarticuler en se débarrassant de cette « charge humaine » au principe de la « tension humaniste » propre au cinéma rossellinien (p. 49). Cette charge, parfois si douloureusement soutenue, appartient de plein droit aux réalisateurs conscients que la construction d'un regard est l'exercice d'un pouvoir, et aux spectateurs apprenant que ce qu'ils regardent les regardent, dans tous les sens du terme.
Les mises en garde de Jean-Louis Comolli se tiennent dans la garde des boucles récursives du regard.
La rétrospective de l'histoire
(cf. « Le miroir à deux faces » in Arrêt sur histoire,
éd. Centre Georges Pompidou-coll. « Supplémentaire », 1997)
Le matérialisme comollien ne l'est qu'en héritant de la prise en compte d'une dialectique innervant le cinéma depuis ses origines. Son champ labouré par les luttes inégales se trouveront historiquement renforcées à la télévision, « ce magasin général du spectacle accumulé ». La télévision, entre le cinéma comme composition à l'adresse du spectateur pris un par un dans les rapports du visible et de l'invisible et la décomposition de ces mêmes rapports dans les flux saturés du spectaculaire (p. 11). « Le miroir à deux faces » est cette intervention qui rappellera d'emblée l'exorbitant pouvoir d'illusion du spectacle cinématographique. Les leurres et les simulacres qu'il promeut se renforçant paradoxalement dans l'analyse qui en ralentit ou en arrête le mouvement, jusqu'au photogramme près. Par exemple dans le modèle décidément paradigmatique offert par L'Homme à la caméra de Dziga Vertov, qui expose la vérité discontinue du cinéma en filmant des photogrammes à l'arrêt à l'aide d'autres, mais qui se succèdent eux à plus d'une vingtaine par seconde.
La jouissance du leurre se supplémente de son savoir dans les relances de la croyance et du soupçon comme de l'illusion et de sa mise en doute, constitutives du plus grand art du cinéma. C'est une part d'ombre du spectateur avec laquelle joue en toute connaissance de cause le cinéma, qui y prend garde dans le savoir de la part d'inconscient logée dans ses machines. De part et d'autre part : l'intervalle des parts accueille la « part non ''instrumentalisée'' du cinéma », celle qui lui aura permis de résister, au bout du compte et du siècle passé, aux dispositifs de propagande idéologique mais, différemment aussi, aux bonnes causes du militantisme politique (p. 14). D'avoir été ignorée pour les besoins du discours idéologique comme de la cause politique qui s'y oppose légitimement, la part d'ambivalence et de subjectivité consiste en ce reste qui complique les images. Ce reste qui résiste en investissant les rapports du proche et du lointain resserre aussi, contre les injonctions de l'extrême-droite, les relations du familier et de l'étranger (ainsi que le montrent certains chefs-d'œuvre de Fritz Lang tels M le maudit en 1931, Fury en 1936, Les Bourreaux meurent aussi en 1943). L'histoire comme objet de représentation cinématographique n'échappe pas à ce constat, comme la pratique du cinéma ne saurait pas davantage se soustraire de l'histoire qui s'y joue et s'y dépose. L'inconscient c'est l'histoire comme le disait Émile Durkheim, c'est de l'histoire incorporée dans des habitus comme l'aura précisé après lui Pierre Bourdieu.
On ne cesse pas de noter l'importance déterminante du corps dans la réflexion comollienne, ses mouvements et ses gestes, en ce qu'ils disent d'une histoire et des rapports conflictuels qui s'y nouent. Cette importance aura d'ailleurs été déjà marquée dans les propos de Dario Fo caractérisant l'art en contretemps de l'acteur comique Totò dans Totò, une anthologie (1978). Les disjonctions critiques de l'histoire peuvent s'inviter jusque dans les injonctions de la commande de circonstance comme dans les jointures de l'écriture (Let There Be Light de John Huston en 1945). Un exemple moins connu est celui offert par Dynamite (1994), ce documentaire de Daniele Segre où un ouvrier prénommé Mario use d'une lampe afin de donner à percevoir ces colonies de grillons, audibles mais imperceptibles, qui ont depuis repeuplé une mine de Sardaigne. Le moment est émouvant, littéralement ébloui d'être transporté par le jeu d'une lampe et de grillons introuvables invitant le spectateur à changer de place imaginairement, de la scène dans la salle à celle qui se déploie depuis l'écran.
Ce jeu bat ainsi le rappel que « la place du spectateur s'inscrit dans la mise en scène », en faisant du spectateur un acteur, « c'est-à-dire un personnage à son tour, enjeu pour les autres personnages qui sont là représentés. » (pp. 20-21). C'est donc dans l'écart entre deux présences, dans l'entre-deux d'une relation tenue et parfois tendue entre le sujet filmant et le sujet filmé, dans le tissage intervallaire des absences et des présences, depuis ce « miroir à deux faces » qu'est l'image documentaire que le spectateur trouvera à s'intercaler dans la position du tiers. En tiers dans Dynamite d'une histoire ouvrière qui n'en finit pas (« o tutti o nessuno », soit « tous ou personne » comme le répète le dynamiteur souterrain Luciano), qui se prolonge en grève mais aussi en mythes et en rêves, en « survivance des lucioles » (Georges Didi-Huberman), en grillons dont la stridulation déborde la clôture idéologique imposée en cette fin des années 1990 par le discours hégémonique de la « fin de l'histoire » (Francis Fukuyama). En tiers encore dans la narration des Mots et la mort. Prague au temps de Staline (1996) de Bernard Cuau où l'instance narratrice ne propose son « je » qu'en raison des fantômes qu'elle convoque à partir d'un corpus d'archives issu du régime stalinien ayant accablé la Tchécoslovaquie après 1945. Le film évoque la subjectivation au travail dans ses questionnements et ses écarts, dans ses divisions et ses frottements, soumise autrement aux effets d'accélération et de virtualisation des échanges économiques. Cela avec une insistance, y compris spectrale (Bernard Cuau est décédé pendant le montage de son film, achevé par Gérald Collas, et la voix troublante qui s'y fait entendre n'est pas la sienne), dont Jean-Louis Comolli demande à raison si elle n'est pas directement « consécutive au désastre européen de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire aux camps, à l'extermination des juifs d'Europe, à la déshumanisation systématique, jusque dans la nomination et la filiation, mise en en œuvre par les nazis » (p. 27-28).
Cette insistance se dit « fatalité documentaire du cinéma » et elle affecterait tous les films faits depuis le premier (p. 30). Elle est la croyance comollienne, la fiction constituante qui s'entretient du relais pratique et circonstancié des films réalisés, y compris les œuvres de propagande comme Desert Victory (1943) de Roy Boulting et La Chute de Berlin (1949) de Mikhaïl Tchiaourelli dont la vérité documentaire consiste à les voir, aussi et surtout, comme des films de fiction. Et, dialectiquement, « le plus beau film de guerre », à savoir pour l'auteur Objective Burma (1945) de Raoul Walsh, de fait « ressemble à un documentaire » (p. 45). Cette persévérance dans la résistance de la non-indifférence depuis l'indifférence, de l'insignifiant depuis les réseaux de codage de l'information et de la communication, de l'anodin contre le spectaculaire, remonte ainsi le fil d'une histoire conflictuelle qui est aussi celle de la foi dans l'idéal communiste et l'exaltation révolutionnaire renversée en conformation publicitaire, l'histoire du faux continuant après coup, dialectiquement, d'exposer la vérité de sa condition de simulacre.
Le mensonge idéologique ne saurait lui-même s'extraire des traces au sol de cette « inscription vraie » évoquée par Serge Daney à l'occasion de réflexions consacrées aux films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Et la relève des archives du mensonge idéologique, prise en charge par le cinéma en sa part documentaire, peut alors sauver « ce qui reste du rêve dans le passage du temps » (p. 37). La relève est après coup, opératoire rétrospectivement, le différé étant structurel à l'opération cinématographique. Preuve en aura d'ailleurs été donnée, et ô combien magistralement, par Images du monde et inscription de la guerre (1988-1989) de Harun Farocki. Cet essai filmé explique en effet qu'il aura fallu plus de trente ans pour que des fonctionnaires de la CIA reconnaissent en 1977 la réalité d'Auschwitz dont la trace, insue et invue, s'était déposée dans les photographies aériennes prises en avril 1944 par des bombardiers étasuniens survolant la Silésie.
Le cinéma a ainsi de l'avenir, comme un relevé des traces existantes qui est la relève de ses propres traces.
Des corps synchrones, d'autres irrémédiables
(cf. « Ici et maintenant, d'un cinéma sans maître ? »
in Cinéma et politique : 1950-1970. Les années pop,
éd. BPI du Centre Pompidou, 2001)
« Ici et maintenant, d'un cinéma sans maître ? » est le titre de l'intervention de Jean-Louis Comolli proposée afin de caractériser l'un des apports de ces fameuses « années pop » qui, du milieu des années 1950 au début des années 1970, auront secoué le monde et les films qui en auront documenté, mis en scène et raconté les ébranlements. L'ouverture du texte se place immédiatement sur le plan de la remise en question de la place habituellement dévolue au spectateur. La place du spectateur est un point de capiton stratégique de la théorie comollienne du cinéma en sa part documentaire, fondamentalement marquée par la triangulation du désir de trois sujets : celui qui filme, celui qui est filmé et le spectateur au milieu de cette relation dont la mise en forme au titre de tiers lui est destinée.
La place du spectateur est un objet de construction et de réflexion, de pratique et d'interrogation : un enjeu de lutte.
Poser les questions caractéristiques des formes militantes inventées à la gauche du communisme étatisé durant les années 1960, toutefois ne suffit pas. Cela ne suffit plus dès lors que l'on peut aussi prendre en considération les questions tout aussi déterminantes de qui parle et de comment ça parle (Jean-Luc Godard dirait : comment ça va). Le cinéma militant, qui est présentement l'objet de la réflexion critique et autocritique de Jean-Louis Comolli, s'inscrit dans cette histoire, non seulement parce qu'il en serait une expression privilégiée, mais aussi parce qu'il est un champ conflictuel entre la préconisation de l'objectivité (par exemple dans la voix objective du commentaire de Misère au Borinage de Joris Ivens et Henri Storck en 1933) et la subjectivité malgré tout qui s'y faufile (par exemple dans le passage des films liés aux groupes Medvedkine de Sochaux et Besançon, de A bientôt j'espère de Chris. Marker et Mario Marret en 1967 à Classe de lutte en 1969 et Lettre à mon ami Pol Cèbe en 1970). C'est l''influence décisive de Jean Rouch qui inscrira toujours davantage dans la pratique du film des retours d'analyse (par exemple sous la forme des voix narratives improvisées contre toute écriture d'un commentaire dans le rythme de l'action des images montées). C'est celle de l'activité théorique et critique menée par l'équipe des Cahiers du cinéma durant les « années rouges » (Alain Badiou). Tout cela aura donc participé à loger dans la dialectique des œuvres, des auteurs et de leurs spectateurs les questions du quoi, du qui et du comment. Ce qui reste, depuis le reflux militant des années 1980, ne consiste pas dans la liste récapitulative et close des chefs-d'œuvre d'un genre supposément fini, c'est une puissance constituante, celle du cinéma, « quelquefois éclatante, ou bien diffuse et sourde, une source, un rayonnement, une magie fulgurante ou fragile, disséminée dans nombre de pratiques et de films, voire de fragments de films produits par ces pratiques. » (p. 36-37).
Des traces et des percées, des indices et des passages, des intensités et des éclats : une « nature fragmentaire » (p. 55), celle que les plus grands films auront su retenir et à laquelle Jean-Louis Comolli tient comme il tient aux sujets filmés qui, dans leurs corps et en leurs gestes, en retiennent la puissance fragile et fulgurante. C'est, exemplaire, le cas de Suzanne Zedet. Personnage secondaire de A bientôt j'espère dignement passée héroïne principale de Classe de lutte, l'inoubliable Suzanne est un corps militant doublé d'être un sujet de désir filmé dans ce que les anthropologues nomment une « auto mise en scène » (p. 38).
Ainsi, Claudine de France rappelle que « (…) certains continuent à penser, contre toute évidence, que le film ethnographique peut échapper à la mise en scène, alors que celle-ci est une donnée inévitable de toute réalisation filmique, même documentaire » (Cinéma et anthropologie, « Préface à la seconde édition », éd. Maison des Sciences de l’Homme, 1989 [1982 pour la première édition], p. XI). Suzanne est un corps un et plusieurs qui se sait filmée et joue avec ce savoir, respectée comme telle à l'image comme au son depuis la synchronisation historique des caméras légères (comme la caméra 16 mm. Éclair-Coutant) et des enregistreurs sonores portatifs (le magnétophone Nagra III) en 1958, définitivement opératoire au début des années 1960. Suzanne figure ainsi un corps synchrone avec son temps, y compris dans l'antagonisme de ses asynchronismes. Synchrone avec le front des luttes sociales d'alors, bouleversées dans leur hiérarchie, comme avec celui des innovations techniques qui en témoignent. Synchrone, Suzanne s'expose et parle, elle est mise en scène et se met en scène, à la fois vue et entendue, dans le cadre et hors cadre.
La figuration humaine sera bouleversée d'avoir affaire désormais, contre toute prétention universaliste, homogénéisatrice et modélisatrice (identifiée à des industries de masse dont Hollywood demeure encore le paradigme spectaculaire), aux effets multiples de « polyphonie et polyrythmie du corps parlant filmé » (p. 39). Suzanne est ainsi une incarnation exemplaire de cette « cinérévolte » évoquée par Jean-Louis Comolli. Parce que l'histoire est conflictuelle, et qu'elle n'est rien tant que celle de ses crises, de ses remises en question, de ses recommencements comme de ses refondations (p. 41). Et cela, depuis que le cinéma projette le monde au point d'en représenter l'une des conditions transcendantales de possibilité : depuis que le monde est devenu « cinémonde » (Jean-Luc Nancy, « Cinéfile et cinémonde » in Trafic, n°50, « Qu'est-ce que le cinéma ? », été 2004, p. 187-188).
Avant l'invention de la synchronisation de l'image et du son qui a paradoxalement induit une manière de banalisation de la parole filmée, neutralisée d'avoir été naturalisée, l'organisation du partage des voix dans Moi, un Noir (1958) de Jean Rouch aura expérimenté l'invention de voix off originales, au principe de la réappropriation symbolique par les corps filmés des images du film dont ils sont les sujets, devenant après coup leurs premiers spectateurs. Le défaut de l'asynchronisme devient ainsi le principe d'un écart par où passe et s'organise la relève d'une dislocation entre les voix et les corps (cette disjonction est encore à l'œuvre dans un autre film important, Le Moindre geste de Fernand Deligny, Jean-Pierre Daniel et Josée Manenti en 1971), de fait raccord avec les fracas de la décolonisation.
Jean-Louis Comolli insiste enfin sur un exemple qui lui est cher, celui de Terre sans pain – Las Hurdes (1932) de Luis Buñuel. Un « secret » habiterait ce film, dont le dévoilement révèle l'impasse de toutes les instrumentalisations, même lorsque les causes militantes sembleraient le mériter : « tout y est dit, et davantage, et plutôt deux fois qu'une. » (p. 47). Le sens y est en effet affirmé jusqu'à la surabondance et la redondance : la misère accablant une région reculée de l'Espagne d'avant la République se montre dans les corps et sur les visages, elle se dit et se redit aussi dans le commentaire qui l'accompagne. Et puis le ton de cette voix, froid, « empreint de quelque chose de supérieur, de magistral » (p. 51). Comme s'il s'agissait d'accentuer la souffrance en la rendant, pour les spectateurs qui s'en croiraient prémunis ou immunisés, résolument irrémédiable. C'est-à-dire sans solution.
On pense en passant à Karl Marx affirmant dans l'introduction à sa Contribution à une critique de la Philosophie du droit de Hegel (1843) qu'il « faut rendre l’oppression réelle plus dure encore en y ajoutant la conscience de l'oppression, et rendre la honte plus honteuse encore, en la livrant à la publicité. ». Les bonnes consciences visées par un certain cinéma militant, sûr de relayer sans réflexion sur le médium employé les bons messages auprès des bonnes âmes portées par un humanitarisme compassionnel qui s'est répandu à la télévision durant les années 1980 (Mireille Dumas en aura été l'un des noms), font les frais d'être spectatrices des corps dont la monstration est celle d'un mal vivre, un excès les mettant en défaut du bien qu'elles croyaient incarnées. Terre sans pain, dont on sait aujourd'hui à quel point il aura été mis en scène par son auteur, est un piège des regards, construit pour dévoiler « cet obscur objet du désir » logé au cœur du désir de voir du spectateur. La scopophilie peut bien alors s'enrouler dans le beau linge de la charité chrétienne, celle-là s'en trouve désœuvrée tandis que celle-ci se voit excédée, jusqu'à toucher à l'impossible. Ce réel-là, à l'instar de la bouche infectée de la petite fille dont on nous apprendra qu'elle est décédée peu de temps après les soins reçus, est comme un nerf à vif. Cela fait mal, irrémédiablement.
La jouissance des maîtres consiste aussi dans « le jouir d'un excès de bonté » et Luis Buñuel, en ce cas comme en d'autres les courts-métrages sans commentaire de Vittorio de Seta, contrarient la tentation de la jouissance sans risque, déliée de toute implication comme de toute remise en question, en en faisant tantôt un objet de scandale, tantôt une vanité inutile (p. 53). Il n'en serait pas autrement du prix à payer si l'on désire effectivement préserver la place du spectateur en la maintenant à distance des logiques de la saturation présidant aux économies spectaculaires du divertissement comme de la charité médiatique : « Telle que chaque dispositif l'aménage, la place du spectateur sera – autant que les travellings – affaire de morale, place risquée. » (p. 54).
14 janvier 2018
Pour lire la seconde partie, cliquer ici.
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...